Très tôt, Toulouse-Lautrec fait de la photographie son alliée. Il s'y appuie pour peindre et se peindre dans les rôles que lui dicte sa fantaisie. Inépuisable comme la vie qu'il traduit avec force et humour, l'art de Lautrec se frotte au nouveau médium, bientôt au cinéma, et en tire maintes étincelles. Les années 1880-1900 voient l'image mécanique se répandre partout et entraîner l'époque vers toujours plus de mouvement, de vitesse, d'inconnu. Une nouvelle relation au temps et à l'espace s'impose aux images fixes. Mais l'ivresse de la vitesse n'est pas exclusive d'autres curiosités. Le travestissement auquel il s'est tant livré dit l'artiste curieux du divers, attentif aux hommes et aux femmes, comme aux cultures, religions et sexualités qui font de la vie moderne le champ de l'imprévu. Le temps d'une pose, Lautrec change d'âge, de sexe ou de continent. N'y voyons pas l'aveu d'une fuite devant son physique contrefait. Point de masques ! L'usage ludique de la photographie confirme, au contraire, le désir de tout peindre. Car Lautrec, ce viveur insatiable, fait oeuvre : son génie expressif, sa vision mordante débordent les limites d'une existence soumise à la souveraineté du jouir.
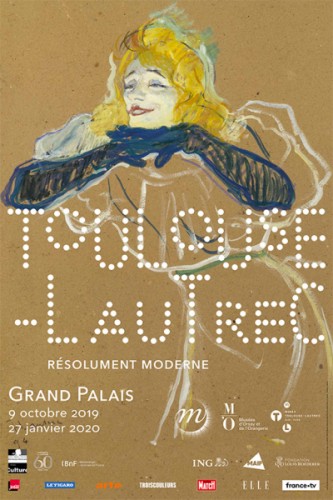
Affiche de l'exposition Toulouse-Lautrec - Résolument moderne © Affiche de la Réunion des musées nationaux- Grand Palais, 2019
C'est en élève consciencieux que le jeune Albigeois s'est formé dans les ateliers parisiens, quittant René Princeteau, peintre du cheval de race, pour des maîtres plus ambitieux. Lautrec, à dix-sept ans, déclare qu'il faut « faire vrai et non pas idéal ». Leçon durable : la peinture est une fiction, mais elle doit s'inscrire dans l'expérience vécue. Alors que le naturalisme de Zola et de Bastien-Lepage enflamme la polémique, Lautrec se fait admettre chez Léon Bonnat. L'ancien ami de Degas reste le représentant d'un hispanisme et d'un réalisme vigoureux qui n'ont rien à voir avec les sucreries de Cabanel et de Bouguereau. Lautrec rejoint, à l'automne 1882, l'atelier de Fernand Cormon, que le Caïn (musée d'Orsay) a rendu célèbre. Lautrec lui doit évidemment une bonne partie de son aisance future à violenter les lumières, activer la perspective, faire saillir les corps, chercher l'animal sous l'humain. Au-delà, l'atelier Cormon se révèle poreux à une autre modernité : « Vive la révolution ! Vive Manet ! », écrit Lautrec en 1883 ou 1884. C'est alors qu'il brocarde, par antiidéalisme, Le Bois sacré de Puvis de Chavannes et peint, nue et drue, sa maîtresse Suzanne Valadon. Ses condisciples, de Van Gogh à Émile Bernard, l'entraînent dans de nouvelles aventures.
Fin 1886, Lautrec publie quelques dessins dans la presse, annonciateurs de la complicité qu'il va entretenir avec l'affiche, l'estampe et le livre illustré. Comme Van Gogh, Henri appartient au clan des « impressionnistes du petit boulevard », sujets plébéiens et manière forte. La série des tableaux et études que lui inspire Carmen Gaudin le confirme. Les modèles féminins se définissent déjà par le flottement de leur statut et de leur identité. De la quinzaine de toiles et dessins conservés, on peut dégager diverses situations, de la femme du peuple à la prostituée des rues. Cette rousse étonnante a littéralement obsédé Lautrec, pour qui le contact avec la vie est primordial. Afin de capter chaque fois un aperçu neuf de son modèle, il l'enveloppe d'une sorte de giration photographique infinie. On aime à croire que Rousse, exposée sous ce titre en 1890, dramatise la nuque et le dos de Carmen. Si la pose reste décente malgré la béance suggérée des cuisses et la vue d'un bas noir, la mise en page et les stries de couleur rappellent Degas et Forain. C'est plutôt des portraits de BastienLepage qu'on rapprochera le profil de Jeanne Wenz, tandis qu'À la Bastille, d'une implacable vérité, rejoint l'imaginaire populaire des chansons à boire d'Aristide Bruant.
Lautrec a jusque-là retenu ses chevaux, n'exposant pas au Salon ou s'en faisant exclure à dessein. Mais tout s'accélère durant l'hiver 1887-1888. Sa peinture s'est décisivement imprégnée des recherches impressionnistes en y faisant le tri que s'imposait un jeune artiste soucieux de secouer l'hédonisme de ses aînés. Avec Van Gogh, Bernard et Anquetin, Lautrec expose dans un restaurant de l'avenue de Clichy. Au même moment, l'avant-garde bruxelloise lui offre une vitrine plus efficace. La Société des XX s'est créée autour de la volonté d'exhiber les audacieux de toute nationalité. En février 1888, onze de ses oeuvres franchissent les frontières. Trois des tableaux exposés alors sont réunis ici, le portrait de la comtesse Adèle, le portrait de Van Gogh et ce que Lautrec tenait pour le chef-d'oeuvre, Au cirque Fernando. Il donne le beau rôle à une jeune rousse, très maquillée, s'apprêtant à se dresser sur le dos d'un cheval au galop, puis à se jeter à travers un écran de papier. Tout est ici déformé et abrégé, des personnages à l'espace volontairement hétérogène, sous l'effet d'une perception qui s'emballe. Une seule autre présence féminine surnage dans cet univers virilisé, avec humour, par la silhouette érectile de Monsieur Loyal et l'impudeur du cheval. Lautrec tire du commun une grâce et une vigueur inattendues.
Avant même que Baudelaire ne l'associe à sa définition du « peintre de la vie moderne », le dandysme masculin en constituait l'essence. Très porté sur Londres, jusqu'à adopter les tendances de la décoration intérieure d'outre-Manche, Lautrec n'a jamais caché son goût pour la culture anglaise. La puissante série de boulevardiers des années 1887-1893 s'en colore, notamment les trois tableaux exposés au Salon des Indépendants de 1891, exceptionnellement réunis ici : les portraits de Gaston Bonnefoy, Louis Pascal et Henri Bourges font aussi penser à Gustave Caillebotte. Cet ancien élève de Bonnat avait su rendre éloquentes ses figures de dos ou de face, les mains souvent plongées dans les poches, le chapeau et la canne exhibés avec une sorte d'assurance virile. Ne peut-on en dire autant de Pascal, Bonnefoy et Bourges ? Ce dernier portrait montre plusieurs châssis au sol et une peinture japonaise au mur. Ce kakémono, mis en abyme, renvoie au format des peintures elles-mêmes. Lautrec n'introduit le japonisme que discrètement. Flamboyant, à l'inverse, retentit le portrait dégingandé de son cousin Gabriel Tapié de Céleyran, promenant son dandysme plus tapageur et plus sombre dans les couloirs de la Comédie- Française. Le monde est une scène.
Dès 1886, alors qu'il se met au service d'Aristide Bruant, Lautrec a compris le potentiel poétique et commercial des lieux de plaisir de Montmartre. Surveillés par la police, ils attirent sur la butte et ses abords une population mêlée, source d'une économie dont participe le monde des journaux et des images. Tout se tient et conforte en Lautrec le souci d'analyser les comportements humains là où ils dévoilent leur part d'animalité et d'excentricité. L'attrait du plaisir ne sourit pas seulement à l'hédonisme du peintre : la danse, les alcools et le sexe sont des révélateurs. Ils transcendent les classes sociales et assurent ainsi au peintre une matière et une dramaturgie nouvelles. Au vu des chefs-d'oeuvre des années 1889-1893, ceux qui imposent le monde inquiétant des bals publics, des cafés-concerts et des cabarets, la presse du temps parle de « comédie funèbre ». Faux : Lautrec ne stigmatise pas plus les enfants du peuple que les nantis. Hommes et femmes s'examinent, se jaugent, se cherchent et parfois se trouvent. Tout un théâtre d'attentes se déploie dans l'espace de tableaux concentrés sur leurs protagonistes. La couleur laisse vivre le dessin souverain et accuse le fantasque des lumières artificielles.
Tout commence par une affiche : à la demande des propriétaires du Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec crée une composition originale qui frappe ses contemporains en 1891. Elle conjugue la puissance plastique de l'image et les nécessités publicitaires. Louise Weber, dite La Goulue, vedette du « chahut », en est le pivot et sa danse provocante est un argument de promotion au même titre que les globes jaunes de l'éclairage moderne. L'artiste est séduit par la vitalité et la gouaille de cette fille qui lui inspire tableaux et lithographies durant les deux années qui suivent. Le succès de la chahuteuse déclinant, elle quitte le Moulin Rouge pour la Foire du Trône en 1895. Devenue indépendante, elle demande à Toulouse-Lautrec de réaliser les deux panneaux destinés à orner la façade de la baraque où elle se produit. L'artiste traite en peintre-décorateur cette commande et imagine un diptyque où il n'oublie pas de se représenter aux côtés de Jane Avril, Félix Fénéon et Oscar Wilde. Le panneau de gauche évoque la gloire passée, celui de droite sa nouvelle vocation. Vendu par La Goulue en 1900, cet ensemble unique sera découpé en huit morceaux par un marchand peu scrupuleux. Heureusement sauvé, l'ensemble reconstitué est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay.
"C'est dans la réalisation des 2 panneaux de La Goulue que Lautrec est allé le plus loin dans la traduction du mouvement. Il utilise même l'inachèvement pour produire la sensation de la danse se déployant dans l'espace. Ces 2 panneaux, nous les présentons dans l'esprit même où ils ont été conçus, comme 2 écrans de cinéma. 1895, c'est l'année où les frères Lumière commencent à projeter ces films qui vont révolutionner le regard." Stéphane Guéguan, co-commissaire de l'exposition "Toulouse-Lautrec - Résolument moderne", Grand Palais, Paris.
Peintre lettré, Lautrec se rapproche de la Revue Blanche vers 1893-1894. Fondée par les trois frères Natanson, Alexandre, Thadée et Louis-Alfred, elle s'ouvre à toutes les tendances d'avant-garde, littéraires ou artistiques, et touche à l'actualité sociale et politique, de l'anarchisme au dreyfusisme en passant par le soutien précoce à Oscar Wilde lors de ses démêlés avec la justice britannique. L'affiche que Lautrec crée pour la revue intrépide, en 1895, est l'une de ses plus puissantes : on y voit l'élégante Misia, femme de Thadée et incarnation du moderne, y évoluer sur la glace. Familier des locaux de la rue Laffitte, reçu par les Natanson, Lautrec fait partie de ceux que Thadée nomme « les peintres de la Revue Blanche »; il côtoie ainsi les Nabis, Bonnard et Vuillard, dont la publication propose des estampes originales. Il se lie à d'autres collaborateurs, notamment Romain Coolus, Tristan Bernard et Paul Leclercq, qui laisseront des témoignages de première main sur lui. Il est également proche de Félix Fénéon, secrétaire, puis directeur de la rédaction, critique d'art influent, qui tient sa peinture pour la plus explosive de son temps. Le théâtre de l'Œuvre aussi offre un espace de collaborations intenses. Mais le même Lautrec est capable d'apprécier un tout autre répertoire, comme celui dans lequel brille Sarah Bernhardt dans les années 1890.
Attiré par les personnalités singulières et soucieux de s'associer à leur succès, Lautrec découvre Yvette Guilbert au Divan Japonais, une salle de spectacle de la rue des Martyrs, à Paris, dès 1890. Elle réunit la rousseur, la gouaille et une audace scénique qui lui permettent d'incarner les figures et les situations humaines les plus différentes, le tout soutenu par des textes d'écrivains. Diseuse et chanteuse, Yvette joue de ses longs bras graciles qu'elle gante de noir, met en valeur sa minceur atypique avec une robe en satin vert ceinturée, au décolleté plongeant, silhouette élégante et distinguée qui contraste avec un répertoire grivois ou satirique. Il faut attendre 1894 pour que le premier projet d'affiche de Lautrec prenne corps, mais Yvette Guilbert lui préfère une image plus flatteuse proposée par Steinlen. Elle autorise, à l'inverse, l'album que l'artiste cosigne avec Gustave Geffroy, bien qu'elle y apparaisse avec son profil au nez « en pied de marmite » (Goncourt). De nombreux croquis ont précédé ces lithographies, fixant sous tous les angles la mobilité du visage, les gestes, les postures, d'un trait allusif et nerveux qui caractérise la divette, pour aboutir à un dessin suffisamment épuré qui ne bascule pas dans la caricature. Sur la couverture, l'arabesque vivante des gants noirs symbolise Yvette Guilbert, synthèse d'une grande force visuelle.
Attentif aux visages comme aux postures, Toulouse-Lautrec traduit son incommensurable passion des femmes dans un ensemble remarquable qui va des portraits de jeunesse aux anonymes filles de joie. Son goût de la provocation le pousse, en effet, à afficher sa fréquentation des maisons closes, voire à s'y installer. S'il avoue, sans faux-semblants, avoir enfin « trouvé des filles à [sa] taille », il y observe également les pensionnaires dans la vérité crue de leur quotidien. Son approche exempte de voyeurisme écarte les fantasmes ordinaires du genre et le scabreux habituel. La suite Elles, publiée en 1896, constitue l'un des sommets de son œuvre lithographié, mais cet album n'aura qu'un succès limité auprès d'un public d'amateurs attiré par des évocations plus érotiques. Ces onze planches qui s'inspirent de L'Annuaire des maisons vertes d'Utamaro évoquent les prostituées aux différentes heures du jour comme autant d'instantanés fugaces, jamais salaces. Sans préjugés d'ordre moral, Lautrec représente aussi les amours saphiques. Au Salon de la rue des Moulins est l'une de ses oeuvres majeures. Réalisée en atelier à partir de nombreuses études sur le vif, elle dépeint des prostituées placides, presque hors du temps, dans la morne tranquillité d'une attente passive, et suggère le luxe étouffant d'un espace clos.
"Le regard qu'il porte sur les femmes est de toute façon un regard très souvent tendre. Quand bien même effectivement il va, pour certaines actrices ou pour certaines chanteuses, exacerber l'expressivité de leur jeu ou de leurs mimiques, il reste respectueux de la femme. Je crois que la meilleure preuve de cette approche, c'est celle qu'il nous donne dans la série « Elles », qui représente des femmes de maisons closes à chaque heure du jour. En fait ce qu'il cherche, c'est, derrière le masque social, la réalité de l'individu. " Danièle Devynck, co-commissaire de l'exposition "Toulouse-Lautrec - Résolument moderne", Grand Palais, Paris.
Élevé dans une famille où l'on s'adonne à l'équitation et à la chasse, Toulouse-Lautrec dessine dès l'enfance des chevaux. On sait son maître René Princeteau fort intéressé par les photographies de Muybridge décomposant le galop d'un cheval et l'on peut donc imaginer que son élève les a vues. Cette capacité à saisir le mouvement et la vitesse trouve une autre expression lorsque, installé à Montmartre, Lautrec est happé par le tourbillon de la vie nocturne dont il choisit d'exprimer les danses fiévreuses. La nervosité de sa ligne et la stridence de son trait se prêtent à la représentation du temps accéléré alors que naît le cinéma des frères Lumière. Les scènes de la vie moderne l'inspirent, du vélo à l'automobile. Il crée ainsi en 1896 une affiche publicitaire pour la Chaîne Simpson, plan fixe dans un format horizontal allongé, servant un récit qui fonctionne comme un tableau animé. En revanche, il ne rencontrera jamais Loïe Fuller, qui ne paraît pas s'être intéressée à son travail. Lui-même peu sensible au discours panthéiste de la danseuse, Lautrec n'en célèbre pas moins la nouveauté chorégraphique dans une série d'estampes où lignes et couleurs s'assemblent en une nuée ascendante.
Lautrec mène sa vie au rythme de sa création, intensément, librement. Mais les plaisirs, le travail acharné, la syphilis, autant que l'abus d'alcool provoquent peu à peu un inéluctable déclin physique qui altère son comportement. À la suite de crises violentes, ses parents le font interner dans une luxueuse clinique privée, à Neuilly, en février 1899. Il ne sera autorisé à en sortir qu'après avoir prouvé sa maîtrise en dessinant trente-neuf scènes de cirque. Clowns et prouesses équestres sont mis en scène dans une dramaturgie accrue par des gradins vides dont la courbe évoque irrémédiablement l'enfermement. Si les toiles qu'il va produire ensuite ont fait l'objet de commentaires pour le moins réservés, elles manifestent pourtant avec brio sa maîtrise retrouvée. La blondeur lumineuse de Miss Dolly, serveuse du Star, lui redonne l'envie de peindre. Les toiles de Bordeaux, notamment la série des Messaline, tout comme Un examen à la faculté de médecine et ses ultimes portraits, tels ceux de Paul Viaud et de Maurice Joyant, prouvent même sa capacité à oser d'autres voies, comme sa liberté souveraine et créatrice.
"Il y a, dans les derniers moments de sa vie, une sorte de dernière effervescence, comme s'il avait voulu prouver que malgré la maladie, malgré l'alcool, il était encore capable d'inventer et de se réinventer.
Ce qui me frappe dans l'œuvre de Lautrec, c'est sa capacité à dire le réel dans toute sa force, à montrer la vie de façon explosive. Il est peut-être le seul à être parvenu à ce degré de vitalité et d'humanité dans la peinture. " Stéphane Guéguan, co-commissaire de l'exposition "Toulouse-Lautrec - Résolument moderne", Grand Palais, Paris.